


Centrale DCC Bluetooth et Android
Centrale DCC V3.4
Centrale DCC V2.5
La sécurité ferroviaire repose sur l’observation directe des signaux ainsi que sur l’application de procédure règlementaire.
Aussi la règlementation doit constamment évoluer pour s’adapter à l’évolution ou la mise en place de nouvelles technologies.
Parfois ces évolutions sont accélérées ou mise en place à la suite d’incident répétitif ou lors d’accident grave. Ces incidents ou accidents conduisent également indépendamment de la technique à des évolutions purement réglementaires pour combattre les dérives constatées ou empêcher certains évènements de se produire.
Nous allons voir ici quelques modifications règlementaires et techniques qui ont été mis en place à la suite de ces accidents.
Dans les années 80 des systèmes de sécurité existent comme :
• La répétition des signaux (RS),
• La VACMA (Veille Automatique à Contrôle du Maintien d’Appui),
• L’ATF (Asservissement Traction Freinage).
Mais durant cette décennie à la suite de plusieurs accidents majeurs, de nouveaux systèmes technologiques ou procédures règlementaires vont voir le jour et venir ainsi renforcer la sécurité des circulations ferroviaires.
Avec le temps seront déployés :
• Le CAPI (Cantonnement Assisté Par Informatique),
• Le DAAT (Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains),
• L’application FLASH (Fiches Lignes et Avis de Service Hebdomadaire) et DELTAS (Dessiner Exactement Le Tracé des Avis Sécurité),
• La VFF (Vérification du Fonctionnement des Freins),
• Le KVB (Kontrôle de Vitesse par Balises),
• La VISA (VItesse Sécuritaire d’Approche),
• L’AU (Asservissement d’Urgence),
• La généralisation plus rapide de l’ATF (Asservissement Traction Freinage).
Tous ces incidents et le nombre d’évènements conduite annuels, ont mené dans un premier temps à l’expérimentation du COVIT (COntrôle de VITesse), qui a ensuite été remplacé par le KVB (Kontrôle de Vitesse par Balise) pour éviter certains évènements et leurs conséquences.
Aussi la règlementation doit constamment évoluer pour s’adapter à l’évolution ou la mise en place de nouvelles technologies.
Parfois ces évolutions sont accélérées ou mise en place à la suite d’incident répétitif ou lors d’accident grave. Ces incidents ou accidents conduisent également indépendamment de la technique à des évolutions purement réglementaires pour combattre les dérives constatées ou empêcher certains évènements de se produire.
Nous allons voir ici quelques modifications règlementaires et techniques qui ont été mis en place à la suite de ces accidents.
Dans les années 80 des systèmes de sécurité existent comme :
• La répétition des signaux (RS),
• La VACMA (Veille Automatique à Contrôle du Maintien d’Appui),
• L’ATF (Asservissement Traction Freinage).
Mais durant cette décennie à la suite de plusieurs accidents majeurs, de nouveaux systèmes technologiques ou procédures règlementaires vont voir le jour et venir ainsi renforcer la sécurité des circulations ferroviaires.
Avec le temps seront déployés :
• Le CAPI (Cantonnement Assisté Par Informatique),
• Le DAAT (Dispositif d’Arrêt Automatique des Trains),
• L’application FLASH (Fiches Lignes et Avis de Service Hebdomadaire) et DELTAS (Dessiner Exactement Le Tracé des Avis Sécurité),
• La VFF (Vérification du Fonctionnement des Freins),
• Le KVB (Kontrôle de Vitesse par Balises),
• La VISA (VItesse Sécuritaire d’Approche),
• L’AU (Asservissement d’Urgence),
• La généralisation plus rapide de l’ATF (Asservissement Traction Freinage).
Tous ces incidents et le nombre d’évènements conduite annuels, ont mené dans un premier temps à l’expérimentation du COVIT (COntrôle de VITesse), qui a ensuite été remplacé par le KVB (Kontrôle de Vitesse par Balise) pour éviter certains évènements et leurs conséquences.
Le 3 août 1985 a lieu l’accident de Flaujac qui fait 35 morts et 120 blessés.
Le chef de service de la gare d’Assier donne le départ à l’autorail Capdenac-Brive n°7924 alors que le train corail Paris-Rodez n°6153 circule sur la ligne en sens inverse.
Sur cette ligne à voie unique le croisement des deux trains aurait dû se faire en gare d’Assier.
Le croisement n’ayant pas eu lieu en gare d’Assier, les deux trains se dirigent l’un vers l’autre sur la ligne à voie unique.
Le chef de service de la gare d’Assier réalise qu’il a expédié le train n°7294 alors que le croisement dans son établissement n’a pas eu lieu comme il est prévu.
Il tente de prévenir le conducteur du train n°7924, mais ne peut éviter la collision frontale des deux trains.
A cette date la sécurité repose entièrement sur l’homme et les procédures.
A la suite du nez à nez des deux circulations, la SNCF va mettre en place le système CAPI (Cantonnement Assisté Par Informatique).
Le chef de service de la gare d’Assier donne le départ à l’autorail Capdenac-Brive n°7924 alors que le train corail Paris-Rodez n°6153 circule sur la ligne en sens inverse.
Sur cette ligne à voie unique le croisement des deux trains aurait dû se faire en gare d’Assier.
Le croisement n’ayant pas eu lieu en gare d’Assier, les deux trains se dirigent l’un vers l’autre sur la ligne à voie unique.
Le chef de service de la gare d’Assier réalise qu’il a expédié le train n°7294 alors que le croisement dans son établissement n’a pas eu lieu comme il est prévu.
Il tente de prévenir le conducteur du train n°7924, mais ne peut éviter la collision frontale des deux trains.
A cette date la sécurité repose entièrement sur l’homme et les procédures.
A la suite du nez à nez des deux circulations, la SNCF va mettre en place le système CAPI (Cantonnement Assisté Par Informatique).
Le système CAPI :
• Il équipe chaque établissement d’une ligne et est utilisé pour augmenter la sécurité sur les lignes à voies uniques utilisant le cantonnement téléphonique et empruntées par des trains de voyageurs,
• Le système CAPI se substitue au téléphone pour les opérations de cantonnement (fonctionnement normal et pénétration en canton occupé),
• Le système CAPI n’agit pas sur le sémaphore de sortie de gare.
En 1990 après l'accident de St Marcelin, le conducteur du train corail n°5640 franchi le sémaphore fermé de sortie de la gare s’en s’en rendre compte, ce qui provoque une collision avec un train Talgo.
A la suite de cet accident un autre système de sécurité est mis en place en complément du système CAPI.
Ce système est capable de provoquer l'arrêt d'un train pour prévenir le risque de nez à nez :
• Le dispositif s'appelle le DAAT (Dispositif d'Arrêt Automatique des Trains),
• Il est situé sur les lignes à une seule voie, unique ou banalisée, non électrifiées parcourues par des trains de voyageurs ou de marchandises dangereuses.
Le DAAT est relié au CAPI. Lorsque les opérations de cantonnement ceux sont déroulées correctement, le crocodile du DAAT est désactivé. Dans le cas contraire le crocodile est actif et provoque l’arrêt du train lorsque celui-ci le franchi.
• Le système CAPI se substitue au téléphone pour les opérations de cantonnement (fonctionnement normal et pénétration en canton occupé),
• Le système CAPI n’agit pas sur le sémaphore de sortie de gare.
En 1990 après l'accident de St Marcelin, le conducteur du train corail n°5640 franchi le sémaphore fermé de sortie de la gare s’en s’en rendre compte, ce qui provoque une collision avec un train Talgo.
A la suite de cet accident un autre système de sécurité est mis en place en complément du système CAPI.
Ce système est capable de provoquer l'arrêt d'un train pour prévenir le risque de nez à nez :
• Le dispositif s'appelle le DAAT (Dispositif d'Arrêt Automatique des Trains),
• Il est situé sur les lignes à une seule voie, unique ou banalisée, non électrifiées parcourues par des trains de voyageurs ou de marchandises dangereuses.
Le DAAT est relié au CAPI. Lorsque les opérations de cantonnement ceux sont déroulées correctement, le crocodile du DAAT est désactivé. Dans le cas contraire le crocodile est actif et provoque l’arrêt du train lorsque celui-ci le franchi.
Le 31 août 1985 le train n°1115 assurant la liaison entre Paris-Austerlitz et Port-Bou déraille près de la gare d'Argenton-sur-Creuse.
Le train circule à ce moment-là à 95 km/h sur une zone de chantier concernant deux aiguilles limitées à 30 km/h.
Le dépassement de vitesse sur la zone de chantier provoque le déraillement du train n°1115, au moment où le train postal n°4438 qui assure la liaison entre Brive et Paris arrive en sens inverse à la vitesse de 100 km/h.
La collision entre les deux circulations se produit à 0h07.
Le bilan de cette catastrophe sera de 43 morts et 40 blessés.
Causes de l’accident :
• Le CRL à sa prise de service n’a pas pris connaissance du dossier ligne correspondant à la modification du plan de voie en gare d’Argenton sur Creuse et des limitations temporaires de vitesse implantées sur le terrain,
• Il n’a pas relevé non plus, faute d’une lecture attentive de l’avis correspondant, le relèvement de vitesse de 40 à 100 km/h au passage du premier chantier,
• Malgré le fait qu’il n’a pas rencontré le TIVD à 40 km/h (remplacé par un taux à 100 km/h) le CRL a maintenu l’allure de son train et a momentanément cessé de surveiller la voie pour examiner ses notes, de telle sorte qu’il s’est laissé surprendre par le TIV 30 d’exécution.
Cela conduit la SNCF à :
• Modifier l’implantation de la signalisation pour éviter une accumulation trop important de signaux temporaires différents dans un intervalle donné, ce qui peut conduire à des interprétations erronées de la situation,
• La prise en compte de la signalisation temporaire implantée sur les lignes qui se faisait jusqu’alors par la consultation de panneaux présents à la feuille (lieu de la prise de service des conducteurs) et par l’annotation personnelle de la part du conducteur des informations sur les lignes parcourues sur un support de son choix.
A la suite de cet incident la SNCF a mis en place une application informatique appelée, FLASH : Fiches-Lignes et Avis de Service Hebdomadaire pour l’information des conducteurs.
Le conducteur sera informé de la présence de chantier ou de modification de la signalisation par des FLH : Fiche Ligne Hebdomadaire.
Cet évènement a mis en évidence que le temps dont disposait le conducteur était insuffisant pour prendre correctement en compte toutes les informations nécessaires à la prise de service (y compris la consultation des tableaux de limitation de vitesse) :
• Ce temps à la prise de service sera augmenté de 8 à 13 minutes,
• De plus un temps de 6 heures par an réparties forfaitairement en 30 minutes par mois (30SC) sera alloué pour :
o Une consultation du dossier archives,
o La mise à jour de la collection personnel de l’agent de conduite.
Quelques années après cette application à évolué vers l’application FLASH 2 et actuellement le suivi se fait en temps réel sur une tablette à disposition du conducteur.
Le train circule à ce moment-là à 95 km/h sur une zone de chantier concernant deux aiguilles limitées à 30 km/h.
Le dépassement de vitesse sur la zone de chantier provoque le déraillement du train n°1115, au moment où le train postal n°4438 qui assure la liaison entre Brive et Paris arrive en sens inverse à la vitesse de 100 km/h.
La collision entre les deux circulations se produit à 0h07.
Le bilan de cette catastrophe sera de 43 morts et 40 blessés.
Causes de l’accident :
• Le CRL à sa prise de service n’a pas pris connaissance du dossier ligne correspondant à la modification du plan de voie en gare d’Argenton sur Creuse et des limitations temporaires de vitesse implantées sur le terrain,
• Il n’a pas relevé non plus, faute d’une lecture attentive de l’avis correspondant, le relèvement de vitesse de 40 à 100 km/h au passage du premier chantier,
• Malgré le fait qu’il n’a pas rencontré le TIVD à 40 km/h (remplacé par un taux à 100 km/h) le CRL a maintenu l’allure de son train et a momentanément cessé de surveiller la voie pour examiner ses notes, de telle sorte qu’il s’est laissé surprendre par le TIV 30 d’exécution.
Cela conduit la SNCF à :
• Modifier l’implantation de la signalisation pour éviter une accumulation trop important de signaux temporaires différents dans un intervalle donné, ce qui peut conduire à des interprétations erronées de la situation,
• La prise en compte de la signalisation temporaire implantée sur les lignes qui se faisait jusqu’alors par la consultation de panneaux présents à la feuille (lieu de la prise de service des conducteurs) et par l’annotation personnelle de la part du conducteur des informations sur les lignes parcourues sur un support de son choix.
A la suite de cet incident la SNCF a mis en place une application informatique appelée, FLASH : Fiches-Lignes et Avis de Service Hebdomadaire pour l’information des conducteurs.
Le conducteur sera informé de la présence de chantier ou de modification de la signalisation par des FLH : Fiche Ligne Hebdomadaire.
Cet évènement a mis en évidence que le temps dont disposait le conducteur était insuffisant pour prendre correctement en compte toutes les informations nécessaires à la prise de service (y compris la consultation des tableaux de limitation de vitesse) :
• Ce temps à la prise de service sera augmenté de 8 à 13 minutes,
• De plus un temps de 6 heures par an réparties forfaitairement en 30 minutes par mois (30SC) sera alloué pour :
o Une consultation du dossier archives,
o La mise à jour de la collection personnel de l’agent de conduite.
Quelques années après cette application à évolué vers l’application FLASH 2 et actuellement le suivi se fait en temps réel sur une tablette à disposition du conducteur.
Présentation des informations sur les modifications d'une section de ligne
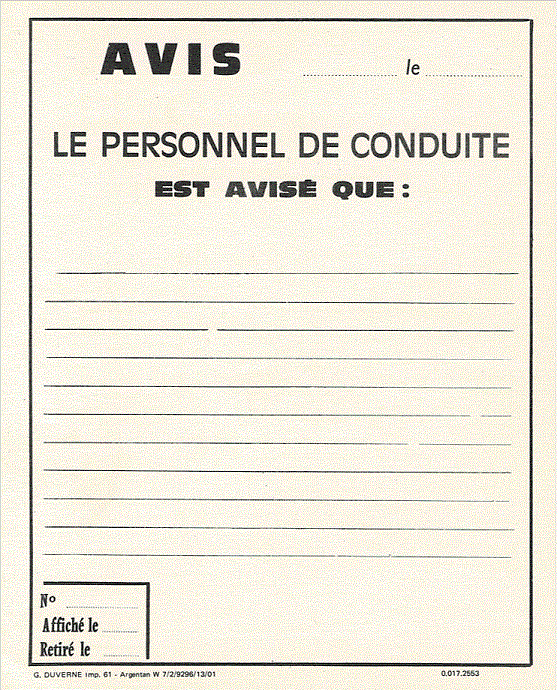
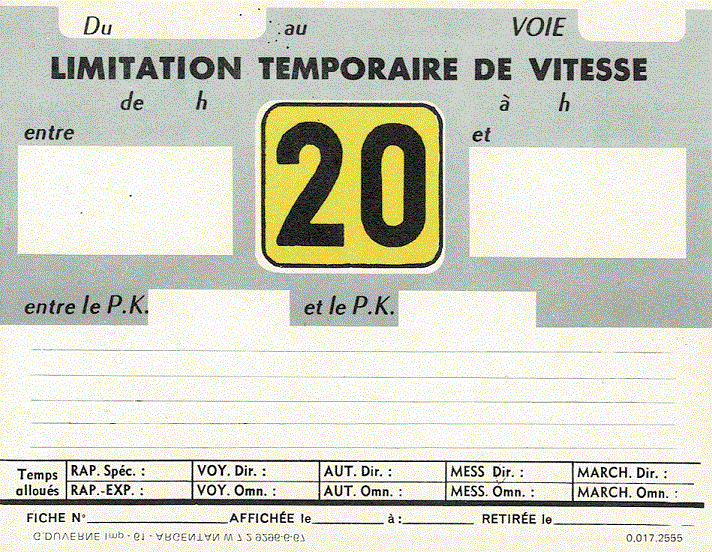
Avis du personnel de conduite
Avis de limitation de vitesse

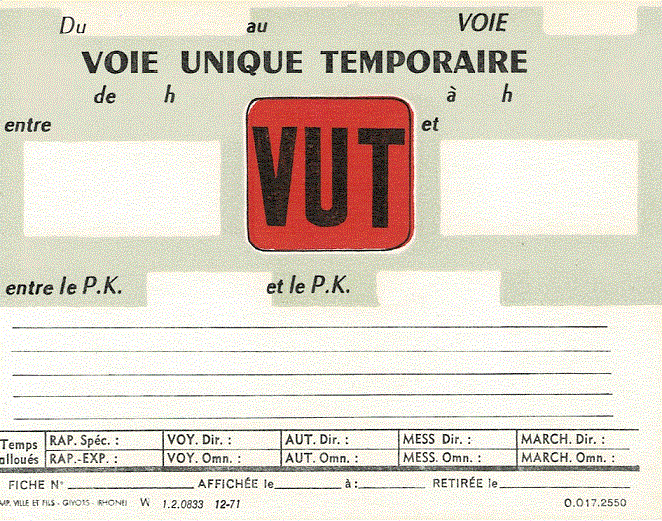
Avis de baissez-panto
Avis de VUT
Avant la mise en place de ces applications, de grands tableaux présents à la feuille (lieu de la prise de service des conducteurs) reprenaient les lignes parcourues par l'établissement du conducteur et des vignettes le renseignaient sur les travaux et les modifications en cours.
Le conducteur devait noter tous ces renseignements sur un support de son choix afin de connaître les modifications effectuées sur la ligne ou la présence de LTV (Limitation Temporaire de Vitesse), ou d'autres signalisation temporaires comme, des VUT des Baissez-Pantos,...).
Le conducteur devait noter tous ces renseignements sur un support de son choix afin de connaître les modifications effectuées sur la ligne ou la présence de LTV (Limitation Temporaire de Vitesse), ou d'autres signalisation temporaires comme, des VUT des Baissez-Pantos,...).
Présentation au conducteur des avis signalisation
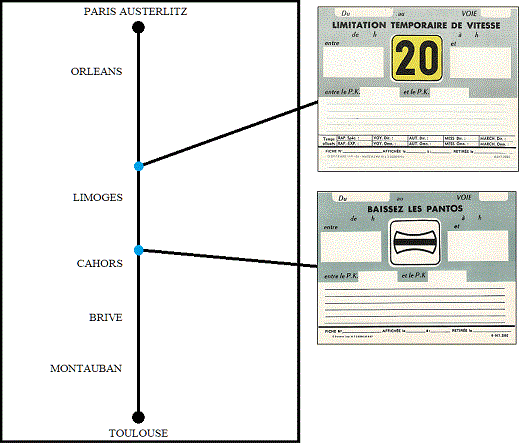
Tableau Avis signalisation
Présentation au conducteur
Le 27 juin 1988 a lieu l’accident de la gare de Lyon qui fait 56 morts et 57 blessés.
Le train n°153944 circule de Melun à Gare de Lyon.
Après un changement de service le 153944 ne dessert plus la gare de Vert de Maisons.
Une passagère s’apercevant que le train ne va pas s’arrêter tire le signal d’alarme. Le train s’arrête en gare de Vert de Maisons.
Le CRL après avoir identifié la voiture ou le signal d’alarme a été tiré, ne parvient pas à le réarmer. (Usure, oxydation...). L’action sur le signal d’alarme provoque la vidange de la conduite générale, ce qui provoque un serrage d’urgence. Dans ces conditions, tant que le signal d’alarme est actif la fuite à la conduite générale demeure et les freins du train restent en serrage maximum.
Le conducteur stressé manipule à plusieurs reprises le robinet d’arrêt de la CG situé entre la première motrice et le reste du train. A la suite de ces manipulations le conducteur constate l’arrêt de la fuite d'air à la CG.
Il laisse le robinet d’arrêt CG fermé pensant l’avoir laissé ouvert (Sur ce type de matériel le robinet est fermé lorsqu’il est parallèle au tuyau).
Le CRL revient en cabine mais ne parvient pas à redémarrer, les freins sont serrés (voiture 2 à 8) alors que le manomètre CG indique 5 bars (pression normale pour obtenir le desserrage des freins).
Le CRL ne comprends pas car pour lui les freins sont censés fonctionner normalement.
Il essaye de remédier au blocage des freins mais n’y parvient pas.
Le CRL décide alors de purger les freins (Réservoir de Commande et Réservoir Auxiliaire des distributeurs de l’ensemble du train).
Après avoir purgé les freins et à ce moment-là seul la 1ère motrice de tête freine. Le reste du train 7 voitures et motrice sont entièrement desserrés.
Les freins sont desserrés et le train repart à vitesse normale, 100 km/h.
En s’approchant de la Gare de Lyon le CRL respecte une transition de vitesse de 105 à 90 km/h en utilisant le frein automatique. La décélération s’effectue.
En arrivant vers la Gare de Lyon un feu jaune clignotant nécessite un nouveau freinage.
Le premier coup de frein léger se passe bien mais lorsque le CRL accentue la dépression, le train ne ralenti pas.
Le train en provenance de la surface et en direction des voies à quai en souterrain, n’a pas assez de puissance de freinage pour respecter la signalisation d’arrêt.
Le train entre en collision avec une rame en stationnement en gare de Lyon à environ 70 km/h.
Causes de l’accident :
• L’accident est dû à l’interruption de la continuité CG entre la première motrice et le reste du train,
• Seul la motrice avait ses freins en état de fonctionnement. Sur le reste du train les freins avaient été isolés et purgés et étaient inactifs.
Cela a conduit la SNCF à :
• Revoir l’implantation et la présence de certains robinets de frein présent sur les matériels,
• A la création d’une nouvelle procédure la VFF (Vérification du Fonctionnement des Freins). Lorsque des manipulations bien précises sont effectuées par le conducteur sur les équipements de freins, notamment la manipulation d’un robinet d’arrêt CG ou après la manœuvre de plusieurs valves de purge des équipements de frein, le conducteur devra effectuer cette vérification, qui lui permet de s’assurer du fonctionnement au serrage des freins ainsi que de la continuité de la CG,
• A la mise en service progressive des SAI (Signal d’Alarme par Interphonie).
Le train n°153944 circule de Melun à Gare de Lyon.
Après un changement de service le 153944 ne dessert plus la gare de Vert de Maisons.
Une passagère s’apercevant que le train ne va pas s’arrêter tire le signal d’alarme. Le train s’arrête en gare de Vert de Maisons.
Le CRL après avoir identifié la voiture ou le signal d’alarme a été tiré, ne parvient pas à le réarmer. (Usure, oxydation...). L’action sur le signal d’alarme provoque la vidange de la conduite générale, ce qui provoque un serrage d’urgence. Dans ces conditions, tant que le signal d’alarme est actif la fuite à la conduite générale demeure et les freins du train restent en serrage maximum.
Le conducteur stressé manipule à plusieurs reprises le robinet d’arrêt de la CG situé entre la première motrice et le reste du train. A la suite de ces manipulations le conducteur constate l’arrêt de la fuite d'air à la CG.
Il laisse le robinet d’arrêt CG fermé pensant l’avoir laissé ouvert (Sur ce type de matériel le robinet est fermé lorsqu’il est parallèle au tuyau).
Le CRL revient en cabine mais ne parvient pas à redémarrer, les freins sont serrés (voiture 2 à 8) alors que le manomètre CG indique 5 bars (pression normale pour obtenir le desserrage des freins).
Le CRL ne comprends pas car pour lui les freins sont censés fonctionner normalement.
Il essaye de remédier au blocage des freins mais n’y parvient pas.
Le CRL décide alors de purger les freins (Réservoir de Commande et Réservoir Auxiliaire des distributeurs de l’ensemble du train).
Après avoir purgé les freins et à ce moment-là seul la 1ère motrice de tête freine. Le reste du train 7 voitures et motrice sont entièrement desserrés.
Les freins sont desserrés et le train repart à vitesse normale, 100 km/h.
En s’approchant de la Gare de Lyon le CRL respecte une transition de vitesse de 105 à 90 km/h en utilisant le frein automatique. La décélération s’effectue.
En arrivant vers la Gare de Lyon un feu jaune clignotant nécessite un nouveau freinage.
Le premier coup de frein léger se passe bien mais lorsque le CRL accentue la dépression, le train ne ralenti pas.
Le train en provenance de la surface et en direction des voies à quai en souterrain, n’a pas assez de puissance de freinage pour respecter la signalisation d’arrêt.
Le train entre en collision avec une rame en stationnement en gare de Lyon à environ 70 km/h.
Causes de l’accident :
• L’accident est dû à l’interruption de la continuité CG entre la première motrice et le reste du train,
• Seul la motrice avait ses freins en état de fonctionnement. Sur le reste du train les freins avaient été isolés et purgés et étaient inactifs.
Cela a conduit la SNCF à :
• Revoir l’implantation et la présence de certains robinets de frein présent sur les matériels,
• A la création d’une nouvelle procédure la VFF (Vérification du Fonctionnement des Freins). Lorsque des manipulations bien précises sont effectuées par le conducteur sur les équipements de freins, notamment la manipulation d’un robinet d’arrêt CG ou après la manœuvre de plusieurs valves de purge des équipements de frein, le conducteur devra effectuer cette vérification, qui lui permet de s’assurer du fonctionnement au serrage des freins ainsi que de la continuité de la CG,
• A la mise en service progressive des SAI (Signal d’Alarme par Interphonie).
Tout au long des années 80 le nombre de franchissement de carré annuel était en moyenne de 100 franchissements par an.
Avec la série d’accident des années 80, notamment celui d’Argenton sur Creuse (1985) et de Novéant (1985), liés à un dépassement de vitesse au franchissement d’appareils de voie et plus tard celui de Melun (1991), la SNCF se rend compte qu’il ne sera pas possible de faire baisser ce chiffre par les moyens conventionnels (formation, accompagnement, suivi des incidents) et prévenir les accidents sans mettre en place un dispositif destiné à améliorer la sécurité.
Le 16 septembre 1992 l'accident de Saint Germain au Mont d’Or fait un mort (l’agent de conduite) et 20 blessés.
Cet accident est dû à un rattrapage de deux trains à la suite du franchissement d'un sémaphore fermé.
Cet accident a confirmé la nécessité de la mise en place d'un dispositif destiné à améliorer la sécurité.
Dans un premier temps un système dénommé COVIT (COntrôle de VITesse) qui est dérivé d’un système utilisé sur le réseau Suédois depuis 1981 et développé par la société Ericsson est mis en place car il permet une mise en œuvre rapide sur le réseau moyennant quelques adaptations.
Il s'agit d'un système qui permet :
• De contrôler la vitesse du train en continu,
• De capter des informations en provenance de balises placées sur les signaux de cantonnement et les TIV (Tableau Indicateur de Vitesse),
Si le système constate un dépassement de vitesse ou une décélération insuffisante lors d’une indication restrictive comme un avertissement ou après le franchissement d’un TIV, le système déclenche alors le freinage d’urgence.
Le COVIT sera expérimenté sur la ligne Paris-Le Havre section de ligne, Poissy-Vernon et Vernon-Rouen.
Le système COVIT est mis en place au début de 1989 sur les lignes :
• Paris-Le Havre,
• Paris-Marseille,
• Paris-Bordeaux,
• Paris-Lille,
• Paris-Aulnoye.
Après l’accident de la gare de Lyon (1988) un programme d’amélioration de la sécurité est lancé et des essais sont réalisés pendant l’année 1990.
En 1991 le système prend le nom de KVB (Contrôle de Vitesse par Balise) et sera testé en condition réelle.
On verra ensuite des déclinaisons de ce système comme :
• Le KVBP (Contrôle de Vitesse par Balise pour les Prolongements) à transmission continue,
• Le KCVB (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Branches de la ligne A et branches de Nanterre-U - Cergy/Poissy),
• Le KCVP (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Prolongements, de la ligne B : Paris-Nord – Roissy/Mitry).
Avec la série d’accident des années 80, notamment celui d’Argenton sur Creuse (1985) et de Novéant (1985), liés à un dépassement de vitesse au franchissement d’appareils de voie et plus tard celui de Melun (1991), la SNCF se rend compte qu’il ne sera pas possible de faire baisser ce chiffre par les moyens conventionnels (formation, accompagnement, suivi des incidents) et prévenir les accidents sans mettre en place un dispositif destiné à améliorer la sécurité.
Le 16 septembre 1992 l'accident de Saint Germain au Mont d’Or fait un mort (l’agent de conduite) et 20 blessés.
Cet accident est dû à un rattrapage de deux trains à la suite du franchissement d'un sémaphore fermé.
Cet accident a confirmé la nécessité de la mise en place d'un dispositif destiné à améliorer la sécurité.
Dans un premier temps un système dénommé COVIT (COntrôle de VITesse) qui est dérivé d’un système utilisé sur le réseau Suédois depuis 1981 et développé par la société Ericsson est mis en place car il permet une mise en œuvre rapide sur le réseau moyennant quelques adaptations.
Il s'agit d'un système qui permet :
• De contrôler la vitesse du train en continu,
• De capter des informations en provenance de balises placées sur les signaux de cantonnement et les TIV (Tableau Indicateur de Vitesse),
Si le système constate un dépassement de vitesse ou une décélération insuffisante lors d’une indication restrictive comme un avertissement ou après le franchissement d’un TIV, le système déclenche alors le freinage d’urgence.
Le COVIT sera expérimenté sur la ligne Paris-Le Havre section de ligne, Poissy-Vernon et Vernon-Rouen.
Le système COVIT est mis en place au début de 1989 sur les lignes :
• Paris-Le Havre,
• Paris-Marseille,
• Paris-Bordeaux,
• Paris-Lille,
• Paris-Aulnoye.
Après l’accident de la gare de Lyon (1988) un programme d’amélioration de la sécurité est lancé et des essais sont réalisés pendant l’année 1990.
En 1991 le système prend le nom de KVB (Contrôle de Vitesse par Balise) et sera testé en condition réelle.
On verra ensuite des déclinaisons de ce système comme :
• Le KVBP (Contrôle de Vitesse par Balise pour les Prolongements) à transmission continue,
• Le KCVB (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Branches de la ligne A et branches de Nanterre-U - Cergy/Poissy),
• Le KCVP (Contrôle Continu de la Vitesse sur les Prolongements, de la ligne B : Paris-Nord – Roissy/Mitry).
La mise en place du KVB a modifié le comportement des conducteurs.
En effet même si le règlement ne l’interdisait pas, si le signal faisant suite à un avertissement s’était réouvert (voie libre), le conducteur ne pouvait pas reprendre sa vitesse car le KVB étant à transmission ponctuelle par balise. Il fallait attendre le franchissement du signal de cantonnement pour capter cette nouvelle information qui permettait de lever les courbes restrictives du KVB afin de reprendre sa vitesse (10 km/h ou 30 km/h).
Cette restriction inhérente au fonctionnement du KVB (transmission ponctuelle) était mal vécu par les conducteurs car en fonction de la catégorie de train (trains de marchandises lourds), la restriction de vitesse était très contraignante.
Suite à l’utilisation du KVB en opérationnel et aux remontées du terrain, une évolution de la règle sur la conduite à tenir lors du franchissement d’un avertissement a été mise en place.
Cette règle dénommée VISA (VItesse Sécuritaire d’Approche) qui sera généralisée en 1995, impose au conducteur en plus de la règle habituelle de l’avertissement, d’être en mesure de franchir le signal suivant n’imposant plus l’arrêt à une vitesse de 30 km/h maximale.
Cette nouvelle mesure a pour bût de réduire le nombre de franchissement de signaux d’arrêt :
• En évitant une reprise prématurée de la vitesse en cas de réouverture du signal (risque de confusion sur l'ouverture du signal notamment pour les signaux en courbe),
• Harmoniser le comportement sur signaux fermés,
• En cas de franchissement, limiter le risque d'engagement du point protégé.
Cette règle évoluera jusqu’à sa décomposition en 3 phases.
Dans le même temps sera implanté une balise dénommé « X » ou de réouverture, à environ 150 mètres du signal pour lever les courbes du KVB en cas de réouverture du signal et qui libèrera le conducteur du franchissement du signal de cantonnement à 10 km/h lorsque celui-ci est à mauvais glissement (aiguille à moins de 200m du signal d’arrêt). La règle de la VISA s’appliquant toujours.
Ainsi à terme, la restriction de franchissement à 10 km/h du signal ne se fera que si le signal est toujours fermé en passant sur la balise "X".
Nota :
L’obligation de se mettre aussitôt que possible à la vitesse de 30 km/h était déjà présente dans la règlementation RATP.
Elle a été découverte par les conducteurs lors de l’interconnexion de la ligne A du RER avec les lignes SNCF de Poissy et Cergy.
On peut également penser que cela à contribuer également à sa transposition dans le règlement SNCF.
En effet même si le règlement ne l’interdisait pas, si le signal faisant suite à un avertissement s’était réouvert (voie libre), le conducteur ne pouvait pas reprendre sa vitesse car le KVB étant à transmission ponctuelle par balise. Il fallait attendre le franchissement du signal de cantonnement pour capter cette nouvelle information qui permettait de lever les courbes restrictives du KVB afin de reprendre sa vitesse (10 km/h ou 30 km/h).
Cette restriction inhérente au fonctionnement du KVB (transmission ponctuelle) était mal vécu par les conducteurs car en fonction de la catégorie de train (trains de marchandises lourds), la restriction de vitesse était très contraignante.
Suite à l’utilisation du KVB en opérationnel et aux remontées du terrain, une évolution de la règle sur la conduite à tenir lors du franchissement d’un avertissement a été mise en place.
Cette règle dénommée VISA (VItesse Sécuritaire d’Approche) qui sera généralisée en 1995, impose au conducteur en plus de la règle habituelle de l’avertissement, d’être en mesure de franchir le signal suivant n’imposant plus l’arrêt à une vitesse de 30 km/h maximale.
Cette nouvelle mesure a pour bût de réduire le nombre de franchissement de signaux d’arrêt :
• En évitant une reprise prématurée de la vitesse en cas de réouverture du signal (risque de confusion sur l'ouverture du signal notamment pour les signaux en courbe),
• Harmoniser le comportement sur signaux fermés,
• En cas de franchissement, limiter le risque d'engagement du point protégé.
Cette règle évoluera jusqu’à sa décomposition en 3 phases.
Dans le même temps sera implanté une balise dénommé « X » ou de réouverture, à environ 150 mètres du signal pour lever les courbes du KVB en cas de réouverture du signal et qui libèrera le conducteur du franchissement du signal de cantonnement à 10 km/h lorsque celui-ci est à mauvais glissement (aiguille à moins de 200m du signal d’arrêt). La règle de la VISA s’appliquant toujours.
Ainsi à terme, la restriction de franchissement à 10 km/h du signal ne se fera que si le signal est toujours fermé en passant sur la balise "X".
Nota :
L’obligation de se mettre aussitôt que possible à la vitesse de 30 km/h était déjà présente dans la règlementation RATP.
Elle a été découverte par les conducteurs lors de l’interconnexion de la ligne A du RER avec les lignes SNCF de Poissy et Cergy.
On peut également penser que cela à contribuer également à sa transposition dans le règlement SNCF.
Le 6 août 1988, le train n°66982 en provenance de Château-Thierry est reçu sur la voie 24 à la gare de l’est à 13h09.
Pour réaliser l’arrêt en gare le conducteur effectue un serrage et constate qu’avec cet effort de freinage la décélération de son train est insuffisante.
Il utilise alors le freinage d’urgence mais le train percute le butoir à une vitesse de 30 km/h.
Conséquence :
Cet accident fait 1 mort.
Cause :
L’accident est dû au fait que la traction n’était pas coupé sur l’engin moteur (BB16647). Ainsi la locomotive produisait un effort de traction en même temps que le train était en serrage.
Le CRL n’avait pas coupé l’effort de traction et le graduateur de l’engin moteur était resté au cran 12 (sur 19 crans de traction) alors que le train était en serrage (le train freinait tout en produisant un effort de traction), ce qui a entraîné une décélération insuffisante lors de la phase d’arrêt.
Résolution :
La coupure de l’effort de traction en ramenant le manipulateur de traction à 0, l’ouverture du disjoncteur ou l’abaissement du pantographe aurait permis d’interrompre l’effort de traction et provoquer l’arrêt du train.
Cet évènement conduira à la généralisation et à l’accélération de l’équipement de l’Asservissement Traction-Freinage (ATF) sur les matériels moteurs.
L’ATF a pour rôle :
• De couper l’effort de traction lorsqu’une commande de freinage est en cours et ce quel que soit la position des commandes de traction,
• Empêcher la reprise automatique de la traction dès que la commande de freinage est annulée et si l'appareillage de l'engin moteur est toujours disposé en traction. La remise à zéro de l'appareillage de traction est obligatoire avant d'avoir la possibilité de reprendre la traction.
L’ATF sera ensuite complété par l’AU (Asservissement d’Urgence).
Pour réaliser l’arrêt en gare le conducteur effectue un serrage et constate qu’avec cet effort de freinage la décélération de son train est insuffisante.
Il utilise alors le freinage d’urgence mais le train percute le butoir à une vitesse de 30 km/h.
Conséquence :
Cet accident fait 1 mort.
Cause :
L’accident est dû au fait que la traction n’était pas coupé sur l’engin moteur (BB16647). Ainsi la locomotive produisait un effort de traction en même temps que le train était en serrage.
Le CRL n’avait pas coupé l’effort de traction et le graduateur de l’engin moteur était resté au cran 12 (sur 19 crans de traction) alors que le train était en serrage (le train freinait tout en produisant un effort de traction), ce qui a entraîné une décélération insuffisante lors de la phase d’arrêt.
Résolution :
La coupure de l’effort de traction en ramenant le manipulateur de traction à 0, l’ouverture du disjoncteur ou l’abaissement du pantographe aurait permis d’interrompre l’effort de traction et provoquer l’arrêt du train.
Cet évènement conduira à la généralisation et à l’accélération de l’équipement de l’Asservissement Traction-Freinage (ATF) sur les matériels moteurs.
L’ATF a pour rôle :
• De couper l’effort de traction lorsqu’une commande de freinage est en cours et ce quel que soit la position des commandes de traction,
• Empêcher la reprise automatique de la traction dès que la commande de freinage est annulée et si l'appareillage de l'engin moteur est toujours disposé en traction. La remise à zéro de l'appareillage de traction est obligatoire avant d'avoir la possibilité de reprendre la traction.
L’ATF sera ensuite complété par l’AU (Asservissement d’Urgence).

